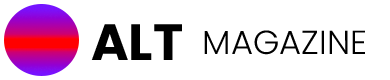Alors que le prix Nobel de la paix a été attribué à Narges Mohammadi, le 6 octobre à Olso, faisant ainsi écho à l’actualité internationale, cette démarche fait figure de diplomatie d’influence et ne manque pas d’être riche en polémique. Selon Mathilde Aubinaud, coordinatrice du think tank Confiance & Gouvernance at Deloitte France, « c’est un signal extrêmement fort pour la démocratie ».
« Soyez aussi notre voix, relayez notre message d’espoir, dites au monde que nous ne sommes pas derrière ses murs pour rien et que nous sommes à présent plus fort que nos bourreaux qui emploient tous les moyens possibles pour faire taire notre société ». Ce cri magnifié par la plume de la militante et journaliste, Narges Mohammadi, en juin 2023, depuis sa prison d’Evin, à Téhéran (Iran), s’est répandu jusqu’aux écoutilles du Comité Nobel norvégien. Celui-ci lui a attribué, vendredi 6 octobre à Oslo le prix Nobel de la paix 2023 soulignant « son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous ».
Cela fait deux années consécutives que le comité Nobel de la paix choisit de récompenser une personne claquemurée à double tour derrière une prison après le biélorusse Ales Bialatsk. Il fut récipiendaire du prix en 2022 pour « ses efforts pour la promotion des droits de l’homme et la démocratie dans son pays » – seule dictature exerçant encore son levier répressif à l’égard de son peuple en Europe.
« Soyez aussi notre voix, relayez notre message d’espoir, dites au monde que nous ne sommes pas derrière ses murs pour rien et que nous sommes à présent plus fort que nos bourreaux qui emploient tous les moyens possibles pour faire taire notre société »
Narges Mohammadi en juin 2023 depuis sa prison d’Evin à Téhéran (Iran)
Ce choix, réfléchi de longue date par le comité Nobel de la paix, est composé de cinq membres – tous exclusivement de nationalité norvégienne- nommés par le Parlement norvégien. Outre leur position d’alors exclusivement européanocentré, leur choix désormais considéré comme « symbolique » fait écho à l’actualité internationale depuis la nomination du politicien vietnamien Phan Dinh Kai en 1974.
Un prix symbolique ou le vivier d’une nouvelle révolution ?
Pour l’heure, il est difficile de déceler un quelconque vivier d’une nouvelle révolution, souhaité par le Comité Nobel. Par exemple, Shirin Ebadi, une autre militante iranienne, qui a œuvré au côté de Narges Mohammadi, récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2003, n’a que peu changé les choses. Selon le chroniqueur international Gauthier Rybinski, sur France 24, « L’espoir des militants prodémocratie de pousser le régime à mener des réformes s’est affaibli avec le temps. Certes, le symbole est substantiel. C’est donc toujours important de noter qu’il y a une partie, non pas de la communauté internationale, mais de l’intelligentsia internationale qui pense à des hommes et des femmes qui sont seuls – parce que, généralement, ils sont seuls dans leur combat. C’est cela qui est capital et qu’on ne mesure pas, et encore plus lorsqu’ils sont incarcérés et reclus dans une cellule, les empêchant d’être non seulement présent lors de la remise du prix, mais aussi de porter leur voix auprès de la communauté internationale ».
Un prix insoumis à l’épreuve du temps
Ce prix éminemment géopolitique et riche en polémique, n’a pas manqué de faire réagir au fil des années. Par exemple, Aung San Suu Kyi, alors en résidence surveillée, avait reçu le prix Nobel de la paix reçu pour son combat en faveur de la démocratie. Cette distinction avait influé sur son sort en lui permettant de gagner un soutien auprès de la communauté internationale. Seulement, quelques années plus tard, l’on se souvient ce qui est advenu d’elle : inaction volontaire due aux exactions fomentées par les militaires envers la minorité musulmane du pays, les Rohingyas.
« Le prix Nobel est, de surcroît, une valeur ajoutée, mais l’être humain change et évolue sans cesse. Parfois, il évolue dans un sens contraire à la rationalité. Oui, peut-être que l’on devisera sciemment sur Mohammadi pendant quelque temps et ce sera déjà un premier pas. Il ne faut pas bouder ce plaisir là, mais l’on passera subrepticement à autre chose comme je vous l’expliquais à propos du sort de cette révolution iranienne. », allègue Gauthier Rybinski.
Une récompense faisant figure de diplomatie d’influence
Le Comité Nobel de la paix se trouve être de plus engagé dans des actions partiales et politiques notamment cette année 2023 où ce prix fut considéré comme le « prix Nobel de l’audace » au vu des réactions vilipendées par le régime iranien dans une veine complotiste « impliquant certains gouvernements européens ». Néanmoins, parler de « soft power de la paix » est erroné, car la nomination de ses membres composant le jury est jalousement gardée, difficile d’accès et en totale neutralité avec les instances et l’Union européenne.
« Le prix Nobel est, de surcroît, une valeur ajoutée, mais l’être humain change et évolue sans cesse. Parfois, il évolue dans un sens contraire à la rationalité. »
Gauthier Rybinski, chroniqueur international sur France 24
Mathilde Aubinaud, invitée sur le plateau de France 24, le 7 octobre 2022, déclarait : « Il s’agit d’accomplir la volonté d’Alfred Nobel avec l’intelligence politique, comme philosophique de notre temps. Il y a une grille de lecture qui est celle de notre société. C’est un signal extrêmement fort pour la démocratie ». La portée de cette distinction dépend ainsi à la fois du contexte géopolitique du pays où résident les différents récipiendaires, de leur écho à l’échelle nationale et internationale, du soutien reçu par les multiples organisations nongouvernementales et du pouvoir politique et crédit accordé par les dirigeants à leur égard. Ce qui est certain, c’est que les ondes des voix des uns et des autres traverseront toujours çà et là les murs des pénitenciers érigés par les bourreaux guerroyant contre la démocratie.
Jessy Lemesle